Qu'est-ce que l'immunité collective ?


Rédigé et vérifié par Le biologiste Samuel Antonio Sánchez Amador
Le terme “immunité collective” est inconnu de la plupart des gens. Récemment, en raison de certaines déclarations dans l’arène politique, il est devenu à la mode et est au centre de nombreux débats concernant le coronavirus.
Mais qu’est-ce que l’immunité collective ? Comment fonctionne-t-elle au niveau individuel et collectif ? Voyons cela en détail ci-dessous.
Une vision à l’échelle individuelle
Tout d’abord, avant de passer aux choses sérieuses, il convient de clarifier ce qu’est l’immunité individuelle :
- Une personne peut devenir résistante à une maladie une fois qu’elle l’a vaincue. Le système immunitaire est capable de se souvenir de certains éléments de la menace, la reconnaissant ainsi plus rapidement lors des réinfections et envoyant des anticorps pour la détruire avant qu’elle ne se reproduise.
- Cela peut se produire, selon la pathologie, avec ou sans symptômes. Dans le cas de COVID-19, il existe de nombreux cas asymptomatiques qui développent une immunité en passant par la maladie sans même s’en rendre compte.
Une fois ce terme brièvement défini, entrons dans le monde de l’immunité collective.
L’immunité collective dans la société
L’immunité collective est un terme qui fait référence à une méthode indirecte de protection individuelle. Cela se produit lorsqu’un pourcentage important de la population est immunisé contre une maladie et que, par conséquent, ceux qui ne l’ont pas contractée ont encore moins de chances de l’attraper.
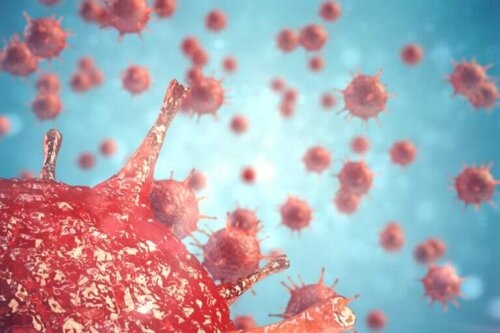
Nous devons voir la propagation d’un agent pathogène comme un réseau :
- Chaque personne infectée peut transmettre l’agent pathogène à un certain nombre de citoyens en bonne santé. La transmissibilité d’un virus est représentée par la valeur R0 ou taux de reproduction de base.
- Si le R0 du coronavirus est de 2 unités, par exemple, cela signifie que chaque personne infectée transmettra la maladie, en moyenne, à 2 autres personnes en bonne santé.
- Ainsi, un réseau est créé dans lequel chaque personne infectée devient plus malade au fil du temps.
Le principe de base de l’immunité collective est de couper cette dynamique expansive. Le fait que le virus atteigne une personne immunisée est une impasse, car il ne peut pas être transmis plus loin. Cela peut permettre d’arrêter ou de ralentir directement la propagation d’une maladie.
Plus il y a de personnes immunisées, plus le virus trouve de points morts lorsqu’il se propage.
Les vaccins reposent sur ce mécanisme, car ils offrent une protection individuelle contre la maladie aux personnes en bonne santé. Ainsi, les personnes immunodéprimées, qui ne peuvent pas être vaccinées, bénéficieront d’un certain degré de protection car elles seront entourées de personnes qui le sont.
Vous pourriez aimer : La terminologie à prendre en compte en période de pandémie
Une question de mathématiques
L’immunité collective, comme tous les termes épidémiologiques, suit des modèles mathématiques. Lorsqu’une proportion critique de la population est devenue immunisée contre une maladie – soit par infection, soit par vaccination – la limite de l’immunité collective est atteinte.
À partir de ce moment, l’agent pathogène est appelé à disparaître avec le temps. Ce point est atteint lorsque la maladie présente un état endémique continu, dans lequel le nombre de personnes infectées n’augmente pas ou ne diminue pas de manière exponentielle.
Dans le calcul de ce paramètre entre en jeu la valeur R0 précédemment exposée. Le symbole S représente la proportion de la population susceptible de contracter la maladie :
R0*S=1
Sans trop entrer dans les chiffres et les maux de tête, nous dirons simplement que plus la valeur S (population sensible) est faible, plus la valeur R0 est faible. Ainsi, il est confirmé que plus l’immunité est grande, moins la maladie se propage.

Pour en savoir plus : Patient zéro : la recherche pendant la pandémie
Immunité collective et coronavirus
Il peut donc sembler tentant de laisser un pourcentage élevé de la population être infecté, car cela finirait logiquement par freiner la maladie selon la théorie que nous avons avancée. Cela pourrait être possible s’il s’agissait d’un virus inoffensif.
Lorsqu’il y a ne serait-ce qu’un pourcentage minime de possibilité que la pathologie se complique dans les groupes à risque, cette stratégie devrait être automatiquement rejetée. Numériquement parlant, cela pourrait être faisable, mais les vies en jeu sont une question éthique et morale plutôt qu’utilitaire.
C’est pourquoi le vaccin contre le coronavirus fait l’objet d’actives recherches. L’existence d’une immunisation réduira considérablement la proportion de personnes sensibles en bonne santé, ce qui ralentira la propagation de la maladie et mettra fin à la pandémie.
Toutes les sources citées ont été examinées en profondeur par notre équipe pour garantir leur qualité, leur fiabilité, leur actualité et leur validité. La bibliographie de cet article a été considérée comme fiable et précise sur le plan académique ou scientifique
- Herd inmunity, wikipedia. Recogido a 5 de mayo en https://en.wikipedia.org/wiki/Herd_immunity.
- COVID-19 science: Understanding the basics of ‘herd immunity’, Alert. Recogido a 5 de mayo en https://www.heart.org/en/news/2020/03/25/covid-19-science-understanding-the-basics-of-herd-immunity.
- Kopecky, K., & Zha, T. (2020). Impacts of COVID-19: Mitigation Efforts versus Herd Immunity (No. 2020-3). Federal Reserve Bank of Atlanta.
Ce texte est fourni à des fins d'information uniquement et ne remplace pas la consultation d'un professionnel. En cas de doute, consultez votre spécialiste.








